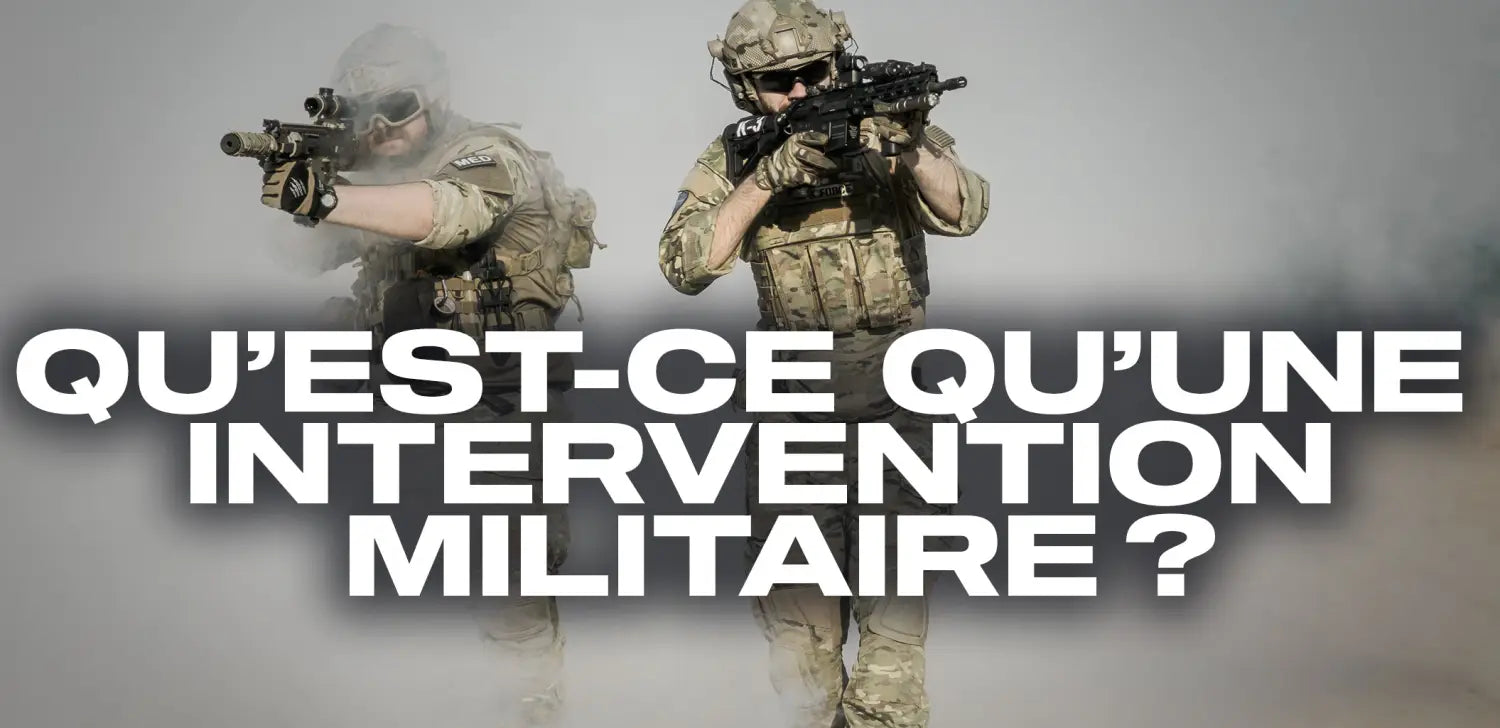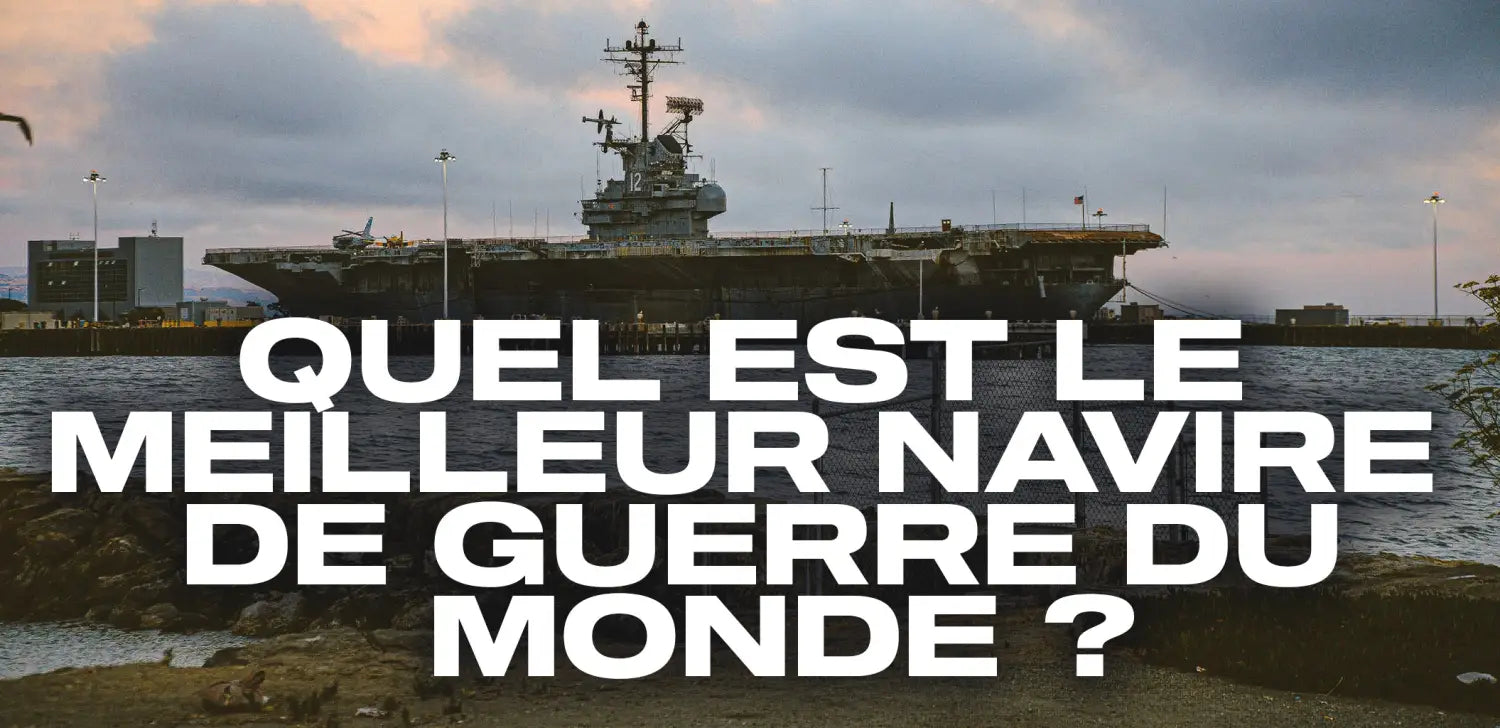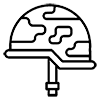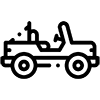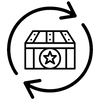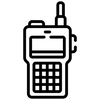Le 20 septembre 1999, le Secrétaire général, dans son rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies, proposait une circonspection sur la sécurité mondiale et l’intervention militaire. Kofi Annan a rappelé que les opérations de l’OTAN en Serbie et au Kosovo seraient une étape marquante, non pas tant marquant une phase décisive de l’intervention humanitaire, mais soulignant plutôt les risques de recours à la force en l’absence d’unité et de légitimité internationale. Le débat général de l’Assemblée générale a confirmé les divergences de vues sur ces questions. Outre les antagonismes idéologiques qui existent dans la compréhension du couple souveraineté-intervention, deux questions principales sont au cœur du débat sur l’intervention militaire. Le premier concerne la nature des actions menées face à des drames tels que le Rwanda, le Kosovo et le Timor oriental, la Tchétchénie, la République démocratique du Congo, et interroge la possibilité de régler ces conflits sur la base d’interventions extérieures. La seconde renvoie au cadre de décision et de légitimation de telles actions. Les deux sont étroitement liés à l’évolution de l’analyse des conflits.
Passez faire un tour dans notre boutique pour acheter des produits militaires (ceinturon armée, chargeur solaire survie, petit sac à dos militaire ...) et profitez de nos offres promotionnelles !
L’intervention militaire est-elle une guerre réinventée ?
La guerre, selon la question initiale, est différente de l’intervention militaire. La question nous demande de savoir ce qui différencie une intervention militaire de l’idée de guerre ou de conflit armé, qu’il s’agisse d’une intervention humanitaire ou non. En fait, selon la question, utiliser un vocabulaire différent signifie que les pays occidentaux ne font plus la guerre.
Certains soutiennent que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements occidentaux n’ont pas appelé les actions militaires étant une guerre, que ce soit dans la décolonisation des colonies ou dans les guerres de projection de force avec l’envoi de forces expéditionnaires dans d’autres pays. Cela fait que beaucoup se demandent si cela est toujours considéré comme une guerre, mais avec des mots différents, ou s’il s’agit d’un nouveau type de guerre, bien que similaire à ce qui existait auparavant.
Portez un collier militaire au quotidien. Et que ce soit tenue de chasse, treillis, chaussures rangers, kits de survie et même des filets de camouflage, vous ne serez pas déçu autant par la diversité que par la qualité sur Surplus-Militaires.
Quelle différence entre guerre et intervention militaire ?
Il n’y a pas de définition incontestée de l’intervention, mais en général il y a une différence entre « intervention » et « guerre ». Quand on dit « intervention », il y a usage de la force et recours aux forces armées, mais en même temps il ne s’agit pas de guerre. En vertu de la Charte des Nations Unies, en plus des articles 51 et 7, les articles 2 et 4 rendent la guerre illégale. Les conditions sont si strictes qu’il vaut mieux nier la guerre quand elle est en cours.
La définition de « guerre » au sens très strict justifie une intervention dans le cadre de la guerre, renvoyant à la définition traditionnelle, alors que l’intervention actuelle n’est pas une guerre contre les États. Les guerres entre nations ne sont pas seulement des guerres entre nations, mais des guerres entre gouvernements. Dans le cas de l’Afghanistan, c’est l’argument à suivre, car ne reconnaissant que l’Afghanistan d’avant-guerre, un conflit avec le régime illégal des talibans est un conflit avec l’État afghan. Dans le contexte de l’intervention, cette notion de « régime » sert à nier le caractère gouvernemental des autorités existantes. Dans le cadre de la Libye, le Conseil de transition est reconnu comme le gouvernement libyen, et combattre Kadhafi, c’est combattre le gouvernement Kadhafi avec le gouvernement libyen légitime.
Est-ce que les interventions sont autorisées ?
Cela inquiète la communauté internationale lorsqu’un conflit armé fait de nombreuses victimes dans un ou plusieurs pays. L’une de ses principales préoccupations était : Puis-je intervenir ? D’un point de vue extérieur, on peut se dire : pourquoi poser cette question ? Les droits de l’homme ont été bafoués, des milliers de personnes ont été tuées... allons-y ! Mais ce n’est pas si simple. La principale caractéristique d’un pays est qu’il est un État souverain. La « souveraineté » signifie que l’État n’a pas à se soumettre à une autre autorité qu’à lui-même. C’est lui qui gouverne ce qui se passe sur son territoire, personne d’autre. La souveraineté nationale implique le principe de non-intervention.
Le principe de non-intervention est universel. Elle est également inscrite dans la Charte des Nations Unies, le document qui établit les principes fondamentaux des relations internationales. L’article 2.4 stipule : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force [...] ». L’article 2.7 stipule : « La présente Charte n’autorise pas les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État […] ».
Par conséquent, l’intervention dans les zones de tension ou de conflit n’est pas toujours évidente en raison de la souveraineté des États et du principe de non-intervention. L’organisme ou l’État intervenant doit invoquer des motifs suffisants pour justifier l’intervention.
Quelles sont les raisons qui justifieraient une intervention militaire ?
Ainsi, selon les Nations Unies, l’intervention militaire ou humanitaire est un éventuel dernier recours en cas de conflit. Cependant, il existe des exceptions qui peuvent justifier le non-respect du principe de non-intervention. Par conséquent, une intervention peut être acceptable si elle est effectuée pour les raisons suivantes.
- Premièrement, si un pays demande à un autre de s’ingérer dans ses affaires, alors l’ingérence devient acceptable.
- Une situation constatée dans un pays qui constitue une menace pour la paix mondiale ou la sécurité internationale.
- Une crise humanitaire fait rage en raison de catastrophes naturelles ou de conflits armés, de violations flagrantes des droits de l’homme.
- Absence de protection des populations lors de crimes contre l’humanité ou de génocide.
Lorsque l’une de ces situations est constatée, il est acceptable que des acteurs (États, ONU, OTAN, ONG) demandent une intervention. Le droit international humanitaire (DIH) et la protection des droits de l’homme sont souvent invoqués. Cependant, lorsque la raison invoquée est une menace pour la paix mondiale, le Conseil de sécurité de l’ONU est la seule autorité qui peut décider si une intervention est acceptable. Aussi, dans tous les cas, il est préférable d’avoir l’appui de cette autorité pour intervenir dans les affaires d’un autre pays (à moins que ce pays ne le demande).
Est qu’intervenir est un devoir ?
Il a été dit que lorsque des civils sont en danger, non seulement nous avons le droit d’intervenir, mais nous avons l’obligation d’intervenir. Ensuite, on parle d’aide humanitaire qui permet un certain niveau d’intervention humanitaire. Il s’agit de venir en aide aux personnes en situation de crise humanitaire (due à des catastrophes naturelles ou à des conflits armés, à un génocide ou à des crimes de guerre, etc.). En 2001, le rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États a introduit un nouveau concept : la responsabilité de protéger. Cette idée a ensuite été relancée lors du Sommet mondial des Nations Unies de 2005, où les chefs d’État ont clairement indiqué qu’ils devaient assumer la responsabilité de protéger leurs populations pendant les conflits armés. Ce qui veut dire :
- Chaque pays a le devoir de protéger son peuple,
- La communauté internationale a la responsabilité d’aider les pays à le faire,
- lorsqu’un pays ne le fait pas, la communauté internationale a la responsabilité de protéger la population.
La souveraineté de l’État représente non seulement des droits, mais aussi des responsabilités, et si l’État ne le fait pas, la communauté internationale doit en assumer la charge. En réalité, cependant, peu de gouvernements prennent des risques politiques, financiers ou même humains pour intervenir dans un autre pays pour aider la population. Lors d’une intervention humanitaire dans un autre pays, le pays qui apporte son aide est souvent motivé par d’autres intérêts (affirmation de ses pouvoirs, prétextes pour s’immiscer dans les affaires de ce pays, visibilité internationale, etc.).

Quand émerge l’interventionnisme ?
Avant le Congrès de Vienne en 1815, et avant les guerres napoléoniennes, il n’y avait pas de concept d’intervention, seulement dans le cadre du système des guerres interétatiques, impliquant deux monarques en conflit sur des questions territoriales, aboutissant généralement à l’annexion d’une partie d’un territoire d’un pays à la possession d’un autre. Avant le Congrès de Vienne, cette guerre d’annexion était considérée comme un événement relativement normal dans les relations gouvernementales, et était même considérée comme un mécanisme de résolution des conflits pour l’allocation des ressources. Le principe de « conquête territoriale » refait surface la possibilité de construire des empires à l’échelle européenne. Après la guerre d’indépendance, Napoléon a envahi certaines parties de l’Europe pour construire un empire européen aux dépens de l’ordre européen. Au Congrès de Vienne, les principes d’annexion et d’intervention sont privés de légitimité. Les nations peuvent recourir à la force, mais nous devons éviter les guerres qui se sont soldées par des annexions comme au XVIIIe siècle.
Qui a instauré l’interventionnisme ?
Au XIXe siècle, l’idée d’intervention est devenue une notion en Europe. Des interventions ont eu lieu depuis 1815, et ont toujours lieu aujourd’hui. Bon nombre des caractéristiques qui existent aujourd’hui sont également présentes dans les interventions qui ont eu lieu à l’époque, notamment le fait qu’une intervention doit être justifiée par de bonnes intentions supérieures aux intérêts individuels ou nationaux. La raison de l’émergence de cette notion était d’empêcher Napoléon ou un autre empire puissant de se former en Europe, afin de protéger le système interétatique que de nombreux États européens considéraient comme essentiel à leur liberté. Le système était considéré comme le seul protecteur contre un tyran potentiel qui pourrait vaincre tous les États européens.
Le principe d’intervention a été contesté
Dans les années 1800, quatre puissances européennes (Empire austro-hongrois, France, Grande-Bretagne et Prusse) et la Russie se sont réunies pour former la Sainte-Alliance. Ils se sont mis d’accord sur des principes qui devraient guider l’intervention dans d’autres pays, à savoir qu’un pays devrait intervenir dans un pays tiers si ses intérêts vont au-delà des intérêts nationaux typiques (par exemple, soutenir une révolte populaire s’il la jugeait justifiée). Les Britanniques ont finalement été en désaccord avec ce type d’intervention, préférant des idées plus libérales sur la souveraineté. Intervenir pour soutenir un monarque absolu n’est pas considéré comme une intervention, selon l’Empire austro-hongrois. Le principe d’intervention est un principe très contesté. Il est considéré dans le cadre du Congrès de Vienne pour protéger le système interétatique, mais lorsqu’un État spécifique intervient, le public s’y opposera, essayant de dire que sa souveraineté était en train d’être redéfinie.
Quelles sont les missions de l’armée ?
Les concepts de sécurité et de conflit évoluent constamment à l’ère de la mondialisation. Ce constat impose un changement stratégique dans l’utilisation de nos moyens de défense nationaux et internationaux. Les stratégies actuelles de défense et de sécurité nationale sont définies par cinq fonctions stratégiques clés : détection et prédiction, prévention, dissuasion, protection et intervention.
À ce titre, le rôle du ministère de la Défense est d’assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts de la France. Il sert également d’autres missions dans le cadre d’accords et de traités internationaux (OTAN) ou régionaux (Europe de la défense). Outre ces réglementations, le ministère fédéral de la Défense intervient également dans les réglementations de droit public. Ses ressources humaines et matérielles soutiennent ou réalisent le travail d’autres ministères et agences dans la vie quotidienne ou dans les situations d’urgence nationales et internationales.
La protection des citoyens français est assurée par les militaires à travers deux opérations principales :
- OPEX (opération extérieure) : Protection des intérêts internationaux de la France à l’étranger à travers l’opération Barkhane au Sahel ou l’opération Chammal en Syrie et en Irak.
- OPINT (opération interne) : Opération Sentinelle pour protéger les citoyens français des menaces terroristes (2015) : Opération Résilience pour venir en aide aux victimes du COVID19 (2020).
Quels sont les OPEX ?
Selon la définition traditionnelle du ministère des Armées, une action extérieure est une « intervention hors du territoire de l’armée française ». La classification des OPEX est basée sur l’arrêté du ministre des Armées et en désignant des zones géographiques et des périodes pertinentes pour ouvrir les lieux de combat. Les OPEX sont différentes des bases en Afrique ou des troupes stationnées en mer dans le cadre de traités de défense.
Dans quel cadre les OPEX se déroulent ?
OPEX se déroule dans le cadre :
- De l’ONU: Côte d’Ivoire (Onuci), Liberia (Minufil), République Démocratique du Congo (Monusco), Liban (Opération Daman menée dans le cadre de la Finul), Sahara occidental (Minurso)
- De l’Union européenne: mandat de la Mission de sécurité européenne pour l’assistance à réforme de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC) s’est achevée en juin 2016. L’opération Atalanta (2008) visait à lutter contre la piraterie navale au large de la Corne de l’Afrique.
- De forces multinationales telles que la Force multinationale d’observation (FOM) dans le Sinaï.
- Et dans le cadre national (l’équipe de protection est montée à bord d’un thonier-senier appartenant à un armateur privé français).
Rôle du soldat durant les OPEX
À l’étranger, les militaires peuvent intervenir pour évacuer des ressortissants français ou alliés, stabiliser des zones dangereuses pour soutenir les civils et soutenir des gouvernements légitimes dans le cadre d’accords internationaux. OPEX est déterminé à protéger les intérêts français, quel que soit le type d’engagement (simple, européen ou global). Les missions OPEX peuvent vous amener :
- Engagez la bataille
- Accomplir des missions dans des zones dangereuses ou hostiles
- Aider les personnes dans le besoin
- Distribution de vivres dans les villages touchés par le conflit
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’aider les habitants. Pour être accepté de la meilleure façon possible, le comportement des militaires doit être exemplaire et respectueux de leurs coutumes.
Les avantages de partir en OPEX
Partir en OPEX des avantages spécifiques notamment :
- Une indemnisation spéciale de sujétion à l’étranger. Elle est versée aux militaires dès lors leurs départs en opération extérieurs (ISSE).
- Votre déploiement sera également considéré pour un développement ultérieur dans l’armée.
Quel salaire en OPEX et combien de temps dure une opération extérieure ?
Selon un rapport de novembre 2016 de la Cour des comptes, l’Allocation de service extérieur (ISSE) 2015 était de 291,3 millions de dollars, impliquant 8 160 salariés. Le coût annuel moyen de l’ISSE est de 35 000 euros par soldat.
Les missions à l’étranger durent généralement quatre mois.
Quelles sont les OPEX en cours ou récentes ?
Certains OPEX sont en cours ou récemment achevés. Ils comprennent l’armée, la marine, l’armée de l’air et de l’espace.
- L’opération Barkhane: lancé le 1er août 2014 en coopération avec le G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et destiné à aider les pays du Sahel dans leur lutte contre les groupes terroristes armés
- L’opération Chammal: lancée le 19 septembre 2014 en collaboration avec leurs alliés dans la région pour apporter un soutien aérien aux forces irakiennes dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé Daech.
- L’opération Daman: Depuis 1978, la France contribue à la Finul au Liban dans le cadre de l’opération Daman. Ses soldats sont principalement armés de Force Commander Reserves (FCR).
- Mission Lynx : Lancée en 2017, l’opération vise à rassurer les alliés d’Europe centrale et orientale qui se sentent menacés par la présence croissante de l’OTAN.
- Mission Aigle: En mars 2022, l’armée française a déployé des troupes sur la base roumaine de Mihail Kogălniceanu. Il s’agit de renforcer la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN contre la guerre d’agression de la Russie sur le flanc oriental de l’Europe et de l’Ukraine.

Pourquoi l’armée française intervient à l’étranger ?
S’il y a une guerre en France, il est logique que les forces armées se battent, car elles doivent directement défendre la sécurité de la France. La situation à l’étranger est quelque peu différente.
Pour aider d’autre pays
Le Mali s’est tourné vers la France pour obtenir de l’aide dans la lutte contre les terroristes parce que l’armée française avait plus d’équipement et d’expérience. Sur le terrain, les soldats français tentaient de vaincre leurs ennemis, mais ils étaient aussi là pour apprendre aux soldats maliens à se relever.
Pour défendre les intérêts de la France
Cela coûte cher d’envoyer des soldats à l’étranger, donc si la France y voit un intérêt, elle le fera. Elle savait que le groupe terroriste menaçait la France, elle a donc participé à des opérations contre l’État islamique en Irak et en Syrie.
Pour avoir un rôle particulier à l’ONU
De plus, la France a une position très particulière dans l’exécution des obligations. En effet, elle est membre permanente du Conseil de sécurité de l’ONU chargé du maintien de la paix dans le monde. Seuls cinq sont membres permanents ! Cela signifie que lorsque certaines décisions sont prises, la France a plus de pouvoir que d’autres pays, ce qui lui donne le sentiment d’avoir son mot à dire sur les questions mondiales.
Ne vous hésitez surtout pas à visiter notre boutique en ligne Surplus militaires pour faire votre achat d'accessoire militaire ou juste pour avoir des conseils et des astuces afin de vivre vos meilleures aventures.