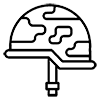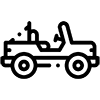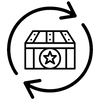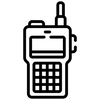Le Rafale de Dassault Aviation est un avion de chasse multirôle, décrit par son constructeur comme un « tout-terrain ». Il a été développé pour la Marine et l’Armée de l’Air françaises, livré le 18 mai 2001 et en service dans la Marine nationale en 2002. Il grée ou équipera également les forces aériennes de l’Égypte, du Qatar, de l’Inde, de la Grèce, de la Croatie, des Émirats arabes unis et de l’Indonésie. Il a mené des missions de bombardement pendant la guerre en Afghanistan (2001-2021), lors de l’opération Serval au Mali, et lors de l’opération Chamar contre Daech en Irak et en Syrie, et interceptée lors de l’intervention militaire de 2011 en Libye et des missions de bombardement.
Passez faire un tour dans notre boutique pour acheter des produits militaires (ceinture armée, chargeur solaire pour téléphone, sac militaire tactique...) et profitez de nos offres promotionnelles !
Quelles sont les caractéristiques du Rafale ?
Voici les caractéristiques de cet aéronef de chasse :
- À aile delta et plans canard,
- À commandes de volée électriques
- Utilise des éléments de furtivité passifs et actifs
- Équipé d’un radar à balayage cybernétique RBE2 et de deux moteurs SNECMA M88.
- Pour la supériorité aérienne, il utilise des missiles air-air et un canon.
- En bombardement tactique, il utilise des bombes guidées laser, des missiles de croisière, des missiles antinavires et, en bombardement stratégique, un missile nucléaire.
Il s’agit d’un aéronef semi-furtif, les configurations delta et canards ne sont pas optimaux en termes de furtivité, car les points d’emport des armes ne sont placés qu’à l’extérieur. Cela dit, des mesures ont été prises pour réduire la signature radar de l’avion-chasseur. L’utilisation généralisée des matériaux composites est la première d’entre elles. Pour réduire sa surface radar effective (SER). Les entrées d’air sont également placées de manière à ce que le moteur ne soit pas visible directement, et les aubes du compresseur sont la principale source de réflectivité radar. En plus des matériaux composites, des matériaux absorbant les ondes radar sont utilisés. Par conséquent, la verrière est recouverte d’une fine couche d’or. Les mesures non divulguées de Snecma ont finalement permis de réduire la signature infrarouge du moteur.
Pour plus de contenus sur l’armée, vêtements et décorations militaires, venez visiter Surplus-Militaires.
Le Rafale est un avion performant
Selon le Général Mercier lors de l’audition de la commission de la défense et des armées, « le Rafale, s’il doit être identifié comme appartenant à une certaine lignée d’aéronefs, à bien des égards, il doit s’agir d’un aéronef de cinquième génération plutôt que d’un aéronef de quatrième génération », il est composé d’aile delta et de plans canard, propulsé par deux turboréacteurs à postcombustion Snecma M88 et commandé par des commandes de volée électriques, lui permettant d’accomplir des tâches impossibles pour la plupart de ses concurrents.
De ce fait, il peut démarrer le cycle à 100 nœuds sous des angles d’attaque élevés, atteignant un facteur de charge de 11 g lors de la démonstration « Rafale solo display 2019 ». Par exemple, l’Eurofighter a tenté sans succès un atterrissage en roulis (un demi-tonneau avant d’effectuer un demi-tour en tangage, laissant l’avion à l’horizontale en sens inverse à une altitude inférieure), et il reste le seul chasseur au monde capable d’y parvenir. Le taux de roulis au ralenti est de 270°/s en configuration légère et de 150°/s en configuration lourde. Il dispose d’un dispositif de démarrage automatique qui permet à l’aviateur de décoller après s’être assis dans le cockpit pendant cinq minutes.
L’entraînement aérien de l’aéroscaphe d’assaut avec des aéronefs des forces alliées, notamment de l’US Navy, a montré qu’il avait souvent l’avantage après deux virages à 90 degrés, grâce à son bon rapport poids/poussée, sa faible charge alaire et son excellence. Les commandes de vol électriques, et l’avantage de son automanette à basse vitesse peuvent passer de la pleine poussée à la pleine postcombustion en moins de quatre secondes.
À Dubaï en 2009, un exercice appelé Advanced Tactical Leadership Course (ATLC) a vu les aéronefs chasseurs les plus modernes s’affronter pour la première fois depuis la base d’Al Dhafra. Un officier pilote Rafale de l’armée de l’air atteste des performances du Rafale.
Un aéronef aérodynamique
Le Rafale est équipé de deux larges plans canards, de quatre becs de bord d’attaque, de quatre gouvernes de profondeur et d’un safran pour optimiser la portance, la traînée et réduire les dérapages lors des différentes phases de volée. Les deux grandes queues de nez peuvent compenser l’inconvénient traditionnel de l’aile delta, qui est la vitesse d’approche lors de l’atterrissage. Le Rafale a une vitesse d’atterrissage de seulement 110 nœuds, tandis que le Mirage III a une vitesse d’atterrissage de 180 nœuds. Comme le Mirage 2000 et la plupart des chasseurs à réaction des années 2000, ses ailes sont conçues pour être subsoniques et aérodynamiquement instables. Cela signifie qu’une augmentation d’incidence provoque le développement d’un couple à cabrer, qui lui-même tend à augmenter la variation d’incidence. Cette caractéristique confère à l’avion une excellente maniabilité. L’inconvénient est que la seule façon de maintenir un aéronef instable dans une attitude stable est d’obtenir des instructions rapides et précises des commandes de volée. Cela ne peut pas être réalisé avec une commande manuelle directe ou des commandes seules.
À cet effet, il est équipé d’un dispositif de commande de vol électrique à fibre optique (CDVO ou FlybyLight) conçu et fabriqué par Dassault Aviation lui-même, une évolution numérique du dispositif de commande de vol analogique installé sur le Mirage 2000. Il fonctionne avec plusieurs niveaux de redondance (3 canaux numériques indépendants et 1 canal analogique de secours), tous alimentés par des alimentations différentes. Le dispositif hydraulique qui alimente les commandes de volée fonctionne au-dessus de 345 bars132 et permet une maniabilité exceptionnelle.
- Combinaison d’une surface alaire relativement grande et d’une charge alaire relativement faible, les ailes delta offrent un bon compromis entre portance et traînée.
- Cette configuration offre également une excellente maniabilité, notamment aux vitesses supersoniques, ainsi qu’un bon rendement aux vitesses supersoniques (jusqu’à Mach 1,8).
- Huit commandes sont montées sur les ailes pour le contrôle de Les bords de fuite des deux ailes ont deux grands ascenseurs qui combinent l’action des gouvernes de tangage (élévateurs) avec l’action de roulis.
- Le bord d’attaque est également équipé de deux lattes mobiles, qui augmentent considérablement la portance. Ce dispositif module l’afflux d’aile pour réduire ou retarder la formation de tourbillons de bout d’aile, une source majeure de traînée.
- Combiné à la profondeur de voilure, les plans canard augmentent la vitesse angulaire de tangage et améliorent ainsi la maniabilité de l’aéronef.
- Les plans Canard sont placés dans une position d’aile fermée, offrant aux aviateurs une meilleure visibilité pour les missions air-sol. En plus de fonctionner comme un volet de frein, il peut également générer un moment de tangage.
- Lors de l’atterrissage, la gouverne de profondeur pointe légèrement vers le bas au lieu de vers le haut, ce qui permet une vitesse d’approche minimale inférieure lors de l’atterrissage. Cependant, la portance est inférieure aux volets d’atterrissage à simple ou double fentes équipant les avions conventionnels.
- Les deux prises d’air pour l’alimentation en air du moteur sont situées latéralement sous le sommet, plutôt que ventralement comme dans le General Dynamics F-16 Fighting Falcon et l’Eurofighter Typhoon. Cette disposition est considérée par le constructeur d’aéronefs comme assurant une meilleure stabilité structurelle du train d’atterrissage avant.
- De plus, deux entrées d’air rendent les deux moteurs complètement indépendants, ce qui augmente la sécurité. Cela réduit le risque d’inhaler des corps étrangers et d’endommager le moteur.
- Camouflage amélioré contre le rayonnement radar entrant (type AWACS) par le haut avec prises d’air, l’un des meilleurs réflecteurs radar dans un aéronef.
- La prise d’air du Rafale n’est pas réglable. Cela simplifie la construction et réduit le poids et les efforts de maintenance, mais au détriment d’un flux d’air optimal pour le moteur et de performances réduites en raison d’une surcharge.
Un cockpit unique
Selon l’aviateur d’essai en chef du Rafale, Guy Miteaux Maurouard, les pilotes étaient traditionnellement positionnés selon la définition du cockpit, mais l’équipe du projet a innové en concevant le cockpit autour d’eux, leur facilitant la vie, lui permettant de se concentrer pour remplir leur mission. Le cockpit est équipé de sièges à éjection zéro/zéro Martin-Baker Mk F16F. Cela signifie qu’il peut planer à zéro mètre au-dessus du sol à grande vitesse et qu’il est équipé d’un parachute GQ Type 5000. Fabriqué en France par SEM-MB, une coentreprise à 50 % entre Safran et Martin-Baker.
Disposant d’un siège d’une inclinaison de 29°, permettant à l’aviateur d’accéder aux instruments et d’assurer une visibilité optimale même à leur petite taille. Une telle inclinaison permet également de réduire la distance verticale entre le cœur et le cerveau du conducteur, facilitant ainsi la résistance aux fortes accélérations. Avec une incidence maximale d’environ 31°, il bénéficie d’une inclinaison de 59°, ainsi grâce à la combinaison anti-G 7g, l’aviateur ne ressent que l’équivalent de 8 g. Le premier casque développé pour Rafale fut le Gueneau 458, remplacé plus tard par le Gallet LA100 et retenu par la Marine et l’Armée de l’Air pour les conducteurs de Rafale et SEM.
Enfin, un Système de Génération d’Oxygène Embarqué (OBOGS) d’Air Liquide permet d’enrichir la teneur en oxygène de l’air prélevé sur le compresseur du moteur et de l’amener directement au navigant. Avec OBOGS, la production d’oxygène est presque illimitée. L’autonomie de l’avion n’est plus limitée par l’alimentation en oxygène de l’aviateur, permettant des missions très longues. Cela simplifie également la logistique en éliminant le besoin de production d’oxygène à terre et le chargement et l’installation de bouteilles de pression à bord.
Quels sont les matériaux du Rafale ?
La surface mouillée de l’aéronef d’assaut est composée d’environ 75 % de matériau composite et représente près de 30 % de la masse totale de l’avion. Par rapport au Mirage 2000, il utilise 7 % de matériau composite en plus. En tenant compte de tous les matériaux non conventionnels, le pourcentage de production s’élève à 50 %, contre seulement 30 % pour l’aéronef de démonstration Rafale A. Le titane est utilisé pour les pièces qui peuvent être impactées, comme les lamelles et les canards. Le bec est également conçu avec un formage superplastique et un soudage par diffusion. Les ailes, les élevons, les gouvernails et environ 50 % de la peau sont en fibre de carbone, tandis que la majeure partie du fuselage est en alliage aluminium-lithium ; des composites thermoplastiques sont également utilisés pour le fuselage. Enfin, le nez où se trouve le radar est en Kevlar. Enfin, le gain de poids obtenu en utilisant ces matériaux est estimé à 300 kg.
Le Rafale : un avion de chasse omnirôle
Au début du programme Rafale, l’Armée de l’Air et la Marine françaises ont exprimé le besoin de remplacer sept types d’avions d’assaut différents par un aéronef « omnirôle » capable d’effectuer toutes les missions.
- Protection aérienne/Supériorité aérienne,
- Appui-feu rapproché,
- Ravitaillement en vol de chasseur à chasseur.
- Reconnaissance,
- Mission nucléaire,
- Frappes air-terre de précision/missions d’interdiction
- Lutte antinavire,
En prenant en compte ces exigences dès le début du développement, le groupe aéronautique métropolitain a pu concevoir un aéronef répondant au plus près aux besoins de chaque mission. Polyvalent et à la pointe de toute mission, le Rafale est un véritable « multiplicateur de force ». Il a démontré une faculté de survie remarquable lors des récentes opérations de l’armée de l’air et de la marine grâce à sa cellule optimisée pour la furtivité et à sa large gamme de capteurs individuels intelligents. Ce sera un combattant militaire gaulois jusqu’en 2050 au moins.
Large gamme de capteurs intelligents et discrets
La rafale dispose de plusieurs radars et capteurs intelligents qui le rend exceptionnel.
Le radar à balayage électronique et à antenne active (RBE2 et AESA)
Le Rafale est le premier et le seul chasseur européen à utiliser un radar matriciel à balayage électronique. Le radar RBE2 est un produit de recherche et développement de Thales. Il bénéficie également du savoir-faire acquis par Thales avec les précédentes générations de radars. Le balayage cybernétique améliore la localisation et le suivi dans des environnements multicibles et offre une connaissance tactique de la situation sans précédent. Avec l’agilité du faisceau permise par le balayage cybernétique et sa vitesse de calcul, les performances et les modes d’utilisation du RBE2 ne se rapprochent pas des radars à antennes mécaniques.
En octobre 2012, le premier Rafale doté d’un radar plus performant, le RBE2 à antenne active, Active Electronically Scanned Array (AESA) est livré à l’Armée de l’Air. Cette antenne remplit les fonctions suivantes :
- Acquisition simultanée air-air et suivie automatique de plusieurs cibles aériennes à très longue portée, vers le bas ou vers le haut, clair ou nuageux, et par tous les temps.
- La faculté de suivre et d’engager des cibles en dehors de la zone de recherche offre un avantage significatif dans le combat aérien.
- Affinage en temps réel des cartes 3D pour un suivi automatique du terrain. Cette fonction permet d’entrer à l’aveugle dans des zones mal cartographiées. C’est actuellement le seul chasseur de nouvelle postérité à radar 2D haute résolution du terrain survolé, permettant la réinitialisation de la navigation, la détection, l’identification et la désignation des cibles au sol.
- Repérage et suivi des navires.
En termes de volume de détection, le radar RBE2-AESA est entièrement compatible avec les futurs déploiements du missile air-air ultra longue portée METEOR. Il a un très fort potentiel de croissance pour l’avenir.
Si la discrétion est la première exigence tactique, le Rafale peut s’appuyer sur plusieurs autres capteurs.
L’optronique de secteur frontal (OSF)
Développé par Thales, l’OSF est entièrement intégré à l’avion. Il est insensible au brouillage radar et offre des facultés passives de localisation et de poursuite à longue portée dans le spectre optronique. Équipé d’une fonction de suivi d’angle haute résolution. Un télémètre laser intégré à l’appareil vous permet de mesurer les distances par rapport à des cibles aériennes, maritimes ou terrestres. L’OSF fournit aux aviateurs les services d’un téléobjectif puissant combiné à une variété de capteurs passifs et actifs pour permettre l’identification visuelle des cibles aériennes selon les règles d’engagement.
Le système interne de guerre cybernétique ou Spectra
Le système interne de guerre cybernétique Spectra, développé par Thales et MBDA, est à la base de la faculté de survie supérieure du Rafale face aux menaces air-air et sol-air de dernière lignée. Entièrement intégré à d’autres dispositifs d’aéronefs pour fournir un avertissement multispectral contre les radars, projectiles et lasers ennemis. Il assure la détection, l’identification et la localisation à longue portée des menaces avec des niveaux de fiabilité supérieurs, permettant aux navigants de réagir immédiatement avec les tactiques les plus appropriées combinant brouilleurs, leurres infrarouges et/ou électromagnétiques et manœuvres d’évitement. Le Spectra peut identifier, éviter ou détruire les menaces au terrain avec une grande précision. Les facultés supérieures de détection et de localisation des menaces aéroportées du Spectra sont des atouts importants dans le développement précoce de situations tactiques de qualité. Pour ce faire, le dispositif s’appuie sur une bibliothèque de menaces internes que les utilisateurs peuvent définir et mettre à jour avec une grande réactivité et une autonomie complète. Le Spectra bénéficie de détecteurs de projectile de nouvelle lignée qui offrent des performances améliorées contre les menaces modernes.

Le partage d’informations en réseau du Rafale
Grâce à l’échange d’informations réseau, le Rafale est véritablement « connecté » avec les autres acteurs du champ de bataille. Ce partage est rendu possible grâce à la fusion de données multicapteurs et à une architecture ouverte qui permet la compatibilité avec de nombreux dispositifs de connectivité de données. Le dispositif de liaison de données haut débit sécurisées le permet d’échanger des données en temps réel avec d’autres aéronefs en patrouille, des centres de commandement sur terre ou aérien, des contrôleurs aériens tactiques ou d’autres organisations. Les liens L16 sont bien sûr disponibles pour les utilisateurs autorisés. En tant qu’acteur du réseau infocentrique, Rafale peut envoyer et recevoir des images. Grâce au dispositif ROVER (Remotely Operated Video Enhanced Receiver), l’équipage peut échanger des images et des vidéos cibles avec les contrôleurs tactiques au sol pour éviter les tirs amis et les dommages collatéraux. C’est un avantage clé dans les opérations de maintien de la paix. Le Rafale est équipé d’une solution de liaison de données de type L16 (OTAN) ou d’une liaison de données spécifique, selon les besoins du client. Interopérabilité éprouvée au sein des dispositifs internationaux.
La nacelle de ciblage et de désignation laser talios
La nouvelle nacelle de visée et de désignation laser Talios de Thales offre au Rafale une surveillance et une désignation laser, jour et nuit, avec une précision métrique. Il peut tirer des armes à guidage laser à un espacement de sécurité. Le capteur infrarouge de la nacelle Talios fonctionne dans le milieu de gamme, il fonctionne donc bien dans les environnements chauds et humides. Ceci est combiné avec une nouvelle lignée de capteurs TV ultra-haute définition. Le Talios est compatible avec toutes les armes à guidage laser.
La nacelle de reconnaissance AREOS avec analyse des données en temps réel
L’armée de l’air et la marine françaises ont choisi d’équiper le Rafale des nacelles de reconnaissance AREOS de nouvelle lignée de Thales pour des missions de reconnaissance tactiques et stratégiques. Un appareil de haute technologie qui peut être utilisé dans une variété de situations, de jour comme de nuit, telles que l’écrémage à haute altitude, à long espacement et à grande vitesse. Pour raccourcir le cycle d’acquisition du renseignement et augmenter le rythme des opérations, la nacelle AREOS est équipée d’un dispositif de liaison de données capable de transmettre en temps réel des images haute résolution aux décideurs militaires. Les performances de la nacelle, notamment sa faculté de tir à longue portée, en ont fait un outil sous-stratégique, comme démontré en Libye, au Mali, en République centrafricaine, en Irak et en Syrie.
Un aéroplane chasseur avec la puissance de la fusion de données
La différenciation du Rafale est le processus d’intégration des données de tous les capteurs. La fusion de données multicapteurs élève les pilotes de simples opérateurs de capteurs à de véritables décideurs tactiques. La fusion des données est réalisée par le calculateur EMTI (Ensemble Modulaire de Traitement de l’Information). Il contient 19 unités commutables par circuit (URL), dont 18 fournissent 50 fois plus de puissance de traitement que le chasseur de la lignée précédente. Il utilise des processeurs et des composants électroniques standard.
Le calculateur EMTI est la clé de l’évolutivité du Rafale. De nouvelles armes et de nouvelles facultés peuvent être facilement intégrées pour le garder pertinent aux assauts à mesure que les exigences tactiques évoluent et que de nouvelles générations de processeurs et de logiciels se succèdent constamment. La fusion des données de plusieurs capteurs est le médiateur de la perception de l’environnement tactique, leur permettant de donner un sens aux situations réelles et de prendre les décisions tactiques appropriées. Utilisant la puissance la puissance de calcul du système, la fusion de données utilise le radar à réseau phasé RBE2-AESA, le dispositif d’Optronique de Secteur Frontal (OSF), le système de guerre cybernétique SPECTRA, l’IFF, le chercheur infrarouge de missile MICA-IR et les connexions de données.
Les avantages de la fusion de donnée multicapteurs
La fusion de données multicapteurs à bord du Rafale permet d’obtenir des images précises, fiables et robustes et peu encombrantes de l’environnement. Par conséquent, cela permet de réduire la charge de travail du conducteur, d’augmenter sa réactivité et finalement d’améliorer la compréhension des situations tactiques réelles. Entièrement automatique en trois étapes :
- Développement de piste intégré et affinement des informations clés fournies par les capteurs,
- En partageant les informations reçues de tous les capteurs, il compense les limitations inhérentes à chaque capteur (longueur d’onde/fréquence, champ de vision, distance, résolution, etc.).
- Évaluation du taux de confiance de chaque trace intégrée et supprimez les icônes de trace redondantes pour éviter d’encombrer l’écran d’affichage.
Une interface homme-machine unique
Le constructeur d’aéronefs, en assurant une meilleure stabilité structurelle du train d’atterrissage avant, a développé une interface homme-machine particulièrement ergonomique et intuitive associant le concept de « Hands on Throttle and Stick » (HOTAS) associé à des écrans tactiles.
Cette interface repose sur un ensemble de dispositifs à haut degré d’intégration qui permet :
- Pour une action à court terme, dirigez le pilote via l’affichage tête haute (HTC) à champ large.
- Dans les actions à moyen et à long terme, restez conscient de la situation tactique dans son ensemble sur l’écran de tête moyen (CTM) couleur multifenêtre. Cette image est collimatée au même espacement que l’affichage tête haute, permettant à l’aviateur de basculer rapidement entre les deux visualisations et le monde extérieur.
- Gestion des ressources système sur un affichage tête haute (VTL) avec un écran tactile bicolore.
La conception sophistiquée de la cabine offre tout ce que l’équipage peut attendre d’un aéronef « Omni rôle » : excellente visibilité avant, latérale et arrière, excellente agilité de manœuvre et siège éjectable incliné à 29° qui ont prouvé leur efficacité dans les climats les plus extrêmes.
L’avion de chasse dispose une large gamme d’armements avancée
Le dispositif d’armes du Rafale repose sur une architecture suffisamment ouverte pour accueillir la plupart des armes actuelles et futures.
L’aéroplane chasseur peut désormais mettre en œuvre :
- Le missile air-air à longue portée METEOR, électromagnétique (EM) à propulsion combinée poudre-statoréacteur dont la combinaison avec les dispositifs d’armes du Rafale génère un changement de paradigme dans le combat aérien,
- Le missile air-air MICA, d’interception, d’assaut et d’autoprotection, dans ses versions IR et il peut être utilisé aussi bien à vue (WVR – within visual range) qu’au-delà de la portée visuelle (BVR, Beyond Visual Range),
- Le missile de croisière SCALP,
- La gamme d’armements AASM air-terre modulaire propulsé HAMMER. L’AASM est équipé d’un kit de guidage GPS/inertiel, d’un kit GPS/inertiel/imagerie infrarouge ou d’un kit de guidage GPS/inertiel/laser,
- Le canon interne NEXTER 30M791 de 30 mm (2 500 coups/min) disponible sur monoplace et sur biplace
- Le missile antinavires AM39 EXOCET,
- Des bombes à guidage laser de 250 kg à 1000 kg et avec différentes charges/effets militaires possibles,
- Des bombes classiques non guidées,
- Des armements spécifiques sélectionnés par certains clients.
L’interopérabilité du Rafale est assurée par le respect de la norme Mil-Std-1760, qui facilite l’intégration du blindage au choix du client.
Le Rafale a un poids de véhicule de 10 tonnes et est équipé de 14 points d’emport (le Rafale M en a 13). Cinq d’entre eux sont conçus pour transporter des armes lourdes et des armures externes. La masse totale des charges externes dépasse 9 tonnes. Un aéronef peut donc emporter dans sa charge utile l’équivalent de sa propre masse. Ravitaillement en vol : Grâce aux nacelles de ravitaillement, l’aéronef lui-même peut ravitailler d’autres chasseurs en vol. Surtout dans l’espace aérien qui est trop exposé à l’action ennemie pour les pétroliers conventionnels. Grâce à sa grande capacité d’emport et à la puissance de son système d’armes, le Rafale peut combiner attaque sur terre et action d’assaut aérien dans une même mission. Vous pouvez exécuter plusieurs tâches simultanément, telles que tirer des missiles air-air dans la phase de pénétration à très basse altitude : cela permet une véritable faculté « omnirôle » et une incroyable aptitude de survie.
Conçu pour faciliter l’exploitation et la maintenance
Le soutien logistique du Rafale a été défini sur la base de l’expérience acquise avec le Mirage 2000 pour lui assurer une excellente disponibilité opérationnelle. Dès le début du développement, le Ministère de la Défense a fixé des exigences très strictes pour le Rafale en matière de Soutien Logistique Intégré (SLI). Grâce à des techniques d’ingénierie simultanées, des choix technologiques audacieux et le logiciel CATIA, ces exigences ont été respectées et même dépassées. Les exemples suivants, sélectionnés parmi une variété de solutions uniques et innovantes, démontrent les progrès en matière de fiabilité, d’accessibilité et de facilité de maintenance.
- Plus de 20 ans d’expérience avec le Mirage 2000 montrent un fort intérêt pour les tests d’intégration des systèmes de navigation et d’armement (SNA). Il a donc été décidé chez Rafale d’étendre ce principe à tous les dispositifs aéroplane. Les tests intégrés, grâce à la précision du diagnostic qu’ils apportent, permettent des remplacements très ciblés sur piste, jusqu’aux cartes électroniques et composants spécifiques.
- Une étude ergonomique approfondie a été menée sous CATIA afin d’offrir un meilleur accès aux éléments de la soute de l’avion, permettant au mécanicien d’effectuer les travaux de maintenance en toute autonomie. Ces études ont permis de réduire le risque d’erreurs d’exécution et la durée de ces opérations.
- Un dispositif centralisé de sécurité des armes élimine toutes les opérations liées au retrait traditionnel des épingles de sûreté à la fin de l’armistice. Il réduit de manière fiable le risque d’accidents et d’erreurs lors de l’utilisation de l’arme et offre un temps de configuration inégalé avec ce délai opérationnel rapide.
- CATIA offre un assemblage mécanique très précis et vous permet de changer d’armes, de viseurs (HUD) ou de radars sans longues sessions de réglage.
- Cela signifie que si le moteur M88 est déposé, il n’aura plus besoin d’être vérifié au banc d’essais moteurs avant remontage. C’est la grande innovation qu’apporte le M88. Le moteur peut être remplacé en une heure et l’aéroplane peut décoller.
Pour assurer une autonomie maximale lors des missions opérationnelles, le Rafale ne nécessite qu’un minimum d’équipements au sol.
- Le système de génération d’oxygène embarqué (OBOGS) élimine le besoin d’un approvisionnement externe en oxygène liquide et des équipements de production et de transport associés au sol.
- Le refroidissement à l’azote des dispositifs optroniques se fait en circuit fermé, donc aucune chaîne d’approvisionnement n’est nécessaire.
- Son groupe auxiliaire de puissance (APU) permet un démarrage automatique.
- Tous les transports sont suffisamment compacts (et éventuellement pliables) pour être en état de navigabilité. Aucune alimentation externe requise. De plus, deux types de chariots suffisent pour attacher et détacher des armes.
Ces caractéristiques d’entretien ont été validées par les spécialistes du support de l’Armée de l’Air et de la Marine française depuis le stade de développement de l’avion, prouvant sa fiabilité aux assauts dans diverses opérations. Cette facilité de maintenance permet aux techniciens d’être rapidement formés sur le Rafale. En quelques semaines, nous pouvons organiser le support aéroplane et la formation à la conversion du Rafale pour un client export, lui donnant l’autonomie comportementale dont il a besoin pour opérer avec succès l’aéroplane.
Des entretiens à petit budget
Le Rafale a considérablement réduit les coûts de maintenance grâce à sa fiabilité supérieure. Le concept d’entretien unique réduit l’entretien et économise les heures de travail et la mécanique. Le Rafale n’a pas besoin de quitter la base d’opérations pour des raisons de maintenance. Contrairement à d’autres types d’aéronefs d’assaut, la cellule et les moteurs du Rafale ne nécessitent plus de gros entretiens réguliers, qui peuvent être longs et coûteux.
Le Fleet Leader compte désormais plus de 3 300 heures de vol, mais les composants structurels qui sous-tendent la robustesse et le concept de maintenance de l’aéronef restent inchangés. L’architecture du moteur M88 à 21 modules représente cette philosophie de maintenance. La révision et la réparation des moteurs ne sont effectuées qu’en renvoyant les modules ou les pièces de rechange aux ateliers centraux ou aux fabricants. Aucun point fixe ou ajustement n’est nécessaire avant la remise en service.
Très tôt dans la conception de l’aéroscaphe, certains composants pouvant affecter la fiabilité ont été supprimés :
- Aérofreins
- Mécanisme d’extension et de rétraction de la perche de ravitaillement
- Parties mobiles des entrées d’air
- Entraînements à vitesse constante (CSD) des alternateurs
En conséquence, les besoins en pièces de rechange, le temps de maintenance et les ressources sur terre sont considérablement réduits. La mission du Rafale confirme qu’aucune infrastructure particulière n’est nécessaire même en cas d’utilisation intensive. L’entretien peut se faire à l’extérieur ou sous un abri temporaire.
Les efforts de standardisation au stade de la conception ont également permis de réduire le nombre de pièces de rechange différentes. Les mêmes normes sont utilisées dans différentes parties de l’avion. Assemblage facile sur tous les sites en utilisant les mêmes normes de pièces grâce à la précision de la fabrication de la machine qui élimine les opérations d’alignement et de réglage lors de l’assemblage de la cellule. Les éléments gauche et droit sont les plus identiques possible : canards, commandes d’asservissement... Divers éléments tels que les vis et les modules électroniques bénéficient également de cette approche. De même, grâce à des possibilités de débogage améliorées, il est possible de changer la carte cybernétique en ligne (URL) de l’unité remplaçable en orbite, au lieu de remplacer l’URL elle-même. Cela facilite le remplacement des lots d’ordinateurs de mission RBE2, SPECTRA, EMTI et d’autres équipements.
Une attention particulière a été portée aux questions d’accessibilité. Par exemple, les ouvertures latérales en haut facilitent le remplacement du siège éjectable. Deux mécaniciens peuvent l’enlever en 10 minutes. L’aéroplane n’utilise pas d’équipements de test externes sur la piste. Tous les dispositifs de test sont intégrés afin que les mécaniciens effectuent des tests sur l’aéroplane. Fini les bancs d’essai moteurs. Il s’agit d’une innovation remarquable dans le domaine de la maintenance des chasseurs. Les nombreuses années d’expérience du constructeur aéronautique dans le traitement de la corrosion dans l’aviation maritime (SUPER ETENDARD) et les patrouilles maritimes (ATLANTIC 1/ATLANTIC 2) ont permis de développer des technologies de protection efficaces. Le Rafale bénéficie ainsi d’une protection anticorrosion utilisant les dernières technologies et contribue à réduire les coûts d’exploitation des avions. En effet, la corrosion découverte lors des visites de maintenance entraîne souvent des retards imprévisibles dans la remise en service de l’aéroplane et des surcoûts.
Les perspectives d’avenir du Rafale
Le Rafale deviendra finalement le seul chasseur utilisé à la fois par la Force aérospatiale française et la Marine nationale. Tout sera mis en œuvre pour maintenir son rôle de premier plan au sein des troupes françaises au-delà de 2040. Depuis 2013, cet aéronef est équipé du nouveau radar à antenne active RBE2-AESA. Ces avions sont également équipés de nouveaux détecteurs de départ de missiles (DDM-NG) et d’une optronique de secteur avancé (OSF-IT) mise à jour avec des facultés de dépistage et d’identification améliorées.
En janvier 2014, le développement de la norme F3-R a commencé. La construction a été achevée en octobre 2018. Cette évolution du standard F3-R s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue du Rafale pour répondre pleinement aux besoins des militaires. Cela a permis à ce constructeur aéronautique gaulois d’intégrer les armes et équipements suivants dans le chasseur :
- Missile air-air Meteor de MBDA. Grâce au radar AESA de toutes les Rafales livrés depuis 2013, ce statoréacteur à très longue portée peut tirer pleinement parti de ses facultés d’innovation. Le premier lancement du Meteor a eu lieu en avril 2015. Un lancement qualificatif a eu lieu en avril 2017, dernière étape avant son entrée en service.
- Nouveau ciblage Talios de Thales. Déployée jour et nuit pour les attaques air-sol, la nacelle utilise les dernières avancées de l’optronique pour étendre la portée d’acquisition et de poursuite des cibles, optimisant ainsi la précision d’attaque du Rafale.
Le standard F3-R comprend également plusieurs modifications visant à améliorer encore l’efficacité et l’interopérabilité du Rafale avec ses alliés français.
En décembre 2018, le développement d’un nouveau standard Rafale F4 a commencé. La logique de gestion du programme Rafale repose sur un développement continu pour adapter l’aéroplane grâce à un standard continu d’évolution technique et de retour d’expérience des opérationnels. La nouvelle solution de connectivité de F4 augmente l’efficacité d’opération connecté et prépare le futur système de combat aérien (SCAF). Cette norme comprend également des mises à niveau pour le radar et l’optronique du secteur avant (OSF), les capacités de vision du casque, l’armement Air-Air Mica NG et Air-Surface AASM de 1 000 kg. La première version de la norme F4 sera disponible à partir de 2022. Une norme complète sera disponible en 2024.
Par ailleurs, des recherches prospectives sont en cours pour un nouveau standard permettant d’équiper le Rafale de facultés air-air et air-sol adaptées à l’exploitation des réseaux de demain à l’horizon de la prochaine décennie. Ces aptitudes assureront entre autres la détection, la poursuite et l’identification des menaces air-air émergentes et amélioreront la faculté de survie du jet grâce au nouveau mode individuel et au dispositif avancé de guerre cybernétique Progress. Le mode air-terre sera équipé d’algorithmes et de capteurs de localisation de cible à résolution accrue pour lutter contre les menaces de plus en plus insaisissables. Enfin, il continue d’étendre ses aptitudes réseau afin de rester à la pointe de la guerre centrée sur l’information de demain.
Histoire du programme Rafale
À la fin des années 1970, les militaires français, en collaboration avec l’Allemagne de l’Ouest, la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Italie, ont exprimé le besoin de développer un nouveau chasseur multirôle embarqué, et en 1985 la France s’est retirée de ses partenaires. Le démonstrateur Rafale a volé le 4 juillet 1986 et le programme démarre le 26 janvier 1988. Le Rafale C monoplace a volé le 19 mai 1991, la version Marine M le 12 décembre 1991 et le biplace B. Le coût total du programme était de 46,4 milliards d’euros.

Les premières études du programme
Après le début de l’étude du programme Mirage 2000, l’armée de l’air française et d’autres agences gouvernementales françaises ont commencé à examiner les spécifications d’un successeur devant entrer en service à la fin des années 1990. La Luftwaffe et le Royal Air Force ont également commencé à utiliser le même type de réflexe. Au milieu des années 1970, les flottes de l’armée de l’air et de la marine française semblaient obsolètes par rapport aux nouveaux aéroplanes de supériorité aérienne américains (F-15, F-16, F/A-18) et soviétiques (MiG-29 et Su-27) ont annoncé leur intention d’acquérir une nouvelle génération de chasseurs polyvalents. L’étude a été réalisée par le Centre d’exploration et d’évaluation (CEPA) du ministère de la Défense, l’avionneur Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation (AMD-BA, devenu Dassault Aviation), l’ingénieur Bruno Revellin-Falcoz, et son bureau d’études. Département de. Le motoriste Snecma lance une étude de faisabilité pour un moteur militaire de nouvelle génération.
La tentative de coopération européenne
En décembre 1977, l’Armée de l’Air charge la Direction des Constructions Aéronautiques du Ministère de la Défense d’étudier un Avion de Combat Tactique (ACT). Le besoin annoncé est simple : un bimoteur léger capable d’effectuer des missions air-air comme des missions d’attaque au sol. Le ministère n’exclut pas la possibilité de construire en coopération avec d’autres pays européens à l’heure actuelle. Les budgets de la protection continuent de diminuer et l’intégration de nouvelles technologies devient de plus en plus coûteuse.
Des pourparlers bilatéraux ont alors commencé entre la France et l’Allemagne et il a été remplacé par le Jaguar, plus tard le Mirage 2000C métropolitain et le F4F Phantom II allemand. Après avoir pris connaissance de cette collaboration en cours, le Royaume-Uni, qui envisage de remplacer les dispositifs de protection aérienne de ses FG Mk1 et FGR Mk2 Phantoms, demande à rejoindre le projet. Des pourparlers tripartites commencent à se mettre d’accord sur d’éventuels besoins communs, des échéanciers et des configurations techniques pour les chasseurs européens. Dès lors, la France opte pour des chasseurs-bombardiers multirôles, tandis que l’Allemagne et la Grande-Bretagne demandent des intercepteurs spécialisés.
En 1978, en réponse aux deux cahiers des charges de l’Armée de l’Air ACT, qui rajoute un deuxième appareil au « Marine Fighter » (ACM) de la Marine nationale, dès 1990, date à laquelle est entamée une réflexion pour la production d’un aéronef polyvalent ACX. Il commencera à fonctionner en 2000. L’industriel gaulois AMD-BA reçoit son premier contrat de recherche le 30 octobre 1978 pour analyser l’impact des nouvelles technologies sur la définition et les performances des dispositifs d’armes (ACT 92). 1995, pour l’Armée de l’Air française. Le besoin opérationnel exprimé est un bimoteur léger capable d’effectuer des missions de protection aérienne et d’attaque à basse et moyenne altitude. Le 22 décembre 1978, un deuxième contrat est signé pour un aéronef « Aviation de Combat Marine » (ACM) pour la Marine nationale française, capable d’effectuer les mêmes tâches que l’ACT. Les enquêtes portent sur la composition des cellules, les dispositifs d’armes et l’armement. En 1979, l’ONERA lance le projet RAPACE pour étudier l’aérodynamique transsonique tridimensionnelle aux grands-angles d’incidence avec une modélisation numérique basée sur les recherches du projet Mirage 2000. Le constructeur aéronautique métropolitain a ensuite acquis des adaptations pour le contrôle actif généralisé (GAC) et le contrôle de vol électrique (CDVE), en utilisant des outils numériques dans sa conception pour réduire les cycles et les coûts de conception. Dès le départ, le constructeur a choisi de développer ses outils de conception numérique en interne avec une petite équipe de 15 personnes. Le programme DRAPO (Computer Drawing and Realization of Aircraft) a donné naissance au logiciel de CAO/FAO CATIA utilisé plus tard. L’ensemble du projet Rafale, de la conception du démonstrateur Rafale A à la production du Rafale série, servira de vitrine commerciale au Groupe Dassault pour former une nouvelle société, Dassault Systèmes. Depuis 1996, il est titulaire d’un doctorat en bourses avec des entreprises technologiques françaises avec une valorisation de plus d’un milliard d’euros.
Au début, Marcel, fondateur du groupe aéronautique métropolitain, avait des sentiments mitigés à propos du Rafale. Il a toujours demandé à ses ingénieurs de concevoir de petits avions pas trop chers et donc exportables. Pour y parvenir, il met dès le départ une forte pression sur l’équipe projet ACX/Rafale, apportant sa touche personnelle à la conception de cet aéroplane. Il était remorqué par un gros porteur, comme le souhaitaient ses partenaires européens. Alors que les recherches françaises se poursuivent, le gaulois AMD-BA, British Aerospace et l’allemand Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) réalisent dans un rapport commun un intercepteur européen unique qui évoque la possibilité de combiner les besoins des trois pays afin de (combattant européen). À l’issue du symposium de l’UEO à Bruxelles en octobre 1979, un groupe appelé « Groupement Européen Indépendant de Programme » (GEIP) est constitué pour étudier les trois projets nationaux « Tactical Fighter » (ACT 92). Air Force « Air Force Target » (AST 403) et Air Force « Tactical Fighter » (TKF 90)
Les recherches d’une coopération franco-américaine
Parallèlement à la tentative de coopération internationale ACT 92, le fondateur du groupe aéronautique métropolitain envisage une coopération franco-américaine avec Grumman sur un aéronef bimoteur propulsé par deux General Electric F404. En juillet 1981, il écrit au président de Grummann, Georges Skurla, lui proposant de créer un bureau d’études commun dans l’un des États membres de l’UE. Le 21 août, Georges Skurla a répondu à Marcel en exprimant son intérêt pour cette collaboration. Skurla a ensuite déclaré que MBB pourrait être inclus dans le projet en tant que troisième partenaire. Le 17 novembre 1981, en l’occurrence, il a d’abord construit un jet avec des F404 et une avionique américaine pour les besoins de l’OTAN, et dans un second temps avec des moteurs SNECMA et une avionique française. Il explique également que Grumman « si vous n’êtes intéressé que par des conseils sur notre processus de fabrication, mieux vaut abandonner ». Finalement, cette coopération franco-américaine n’a pas abouti et la seule coopération possible actuellement à l’étude est entre AMD-BA, MBB et British Aerospace.
Le démonstrateur par pays
À la suite de la décision de coopération des États membres du GIEP, les industriels AMD-BA, MBB et British Aerospace ont décidé de travailler sur un appareil commun appelé l’Avion de Combat Européen (ACE) métropolitain et de l’European Combat Aircraft (ECA). En français et en anglais. Un rapport final a été soumis le 3 avril 1980, spécifiant les éléments de conception de la cellule, de l’équipement, des dispositifs d’armes et de la motorisation. L’aviation et l’industrie militaires européennes mettront à disposition en 1992 des bimoteurs, des bimoteurs, des ailes delta polyvalentes équipées d’avions-canards et de commandes de vol électroniques capables de vitesses de Mach 2 et d’altitudes jusqu’à 15 000 mètres. Controverse sur le poids des jets, les moteurs et, dans une moindre mesure, l’avionique.
Cependant, le constructeur proposa de mener des recherches communes et de construire deux démonstrateurs différents, la première volée étant prévu pour la mi-1984, suivi de 12 prototypes prévus pour la mi-1987. Le premier appareil d’une série de 900 sera livré en 1991. Les composants et sous-ensembles sont recherchés, testés et fabriqués sur des sites communs (hors dispositifs de guerre électronique), chaque pays conservant une chaîne d’assemblage. Accord conclu le 10 décembre 1981 à l’exception du moteur. À l’époque, le gouvernement français, dirigé par Pierre Mauroy, voulait mettre Snecma en difficulté et ne pouvait accepter les demandes britanniques de fourniture de moteurs Rolls-Royce. En septembre, le ministère britannique de la Défense au salon aéronautique de Farnborough financera 70 millions de livres sterling pour la construction d’un démonstrateur du programme d’aéronef expérimental (EAP) basé sur ACA et invitera d’autres partenaires européens du programme PANAVIA à se joindre annoncé36. Certains points de conception d’ACA/EAP empêchent les Français de participer à ce projet.
La mésentente cordiale en 1983-1985
En 1983, l’ACX métropolitain et l’EAP anglo-allemand sont officiellement lancés, ce dernier intégrant les travaux du TKF-90 allemand. Les spécifications des deux prototypes correspondent à celles de 1979, avec une utilisation intensive de matériaux composites tels que la fibre de carbone, le titane plus, la fibre aramide (Kevlar) et l’alliage d’aluminium lithium pour l’ACX. ACX bénéficie également de l’expérience de contrôle de volée cybernétique « Full Authority » d’AMD-BA. Il a été développé par un avionneur gaulois de 1975 (Mirage 2000) à 1986 et était basé sur des volées d’essai ACX. Le CEPA du ministère métropolitain de la Défense a réuni le directeur général technique Bruno Revellin-Falcoz et a été assisté par le directeur général technique Jean-Jacques Samin et Jean-Claude Hironde, qui a conduit le projet ACX/Rafale de la conception aux essais en sustentation. Le 22 juillet 1983, le ministre français de la Défense, Charles Hernu, a approuvé l’enregistrement d’un contrat de recherche, de construction et d’essais en sustentation de l’ACX. En retour, l’État exige un paiement initial élevé de 50 % du total des trois grands fabricants, AMD-BA, Thomson et Snecma.